Les Marraines de la mafia : un exemple dans le combat pour l’égalité ?
- Romane Carlin

- 6 juil.
- 4 min de lecture
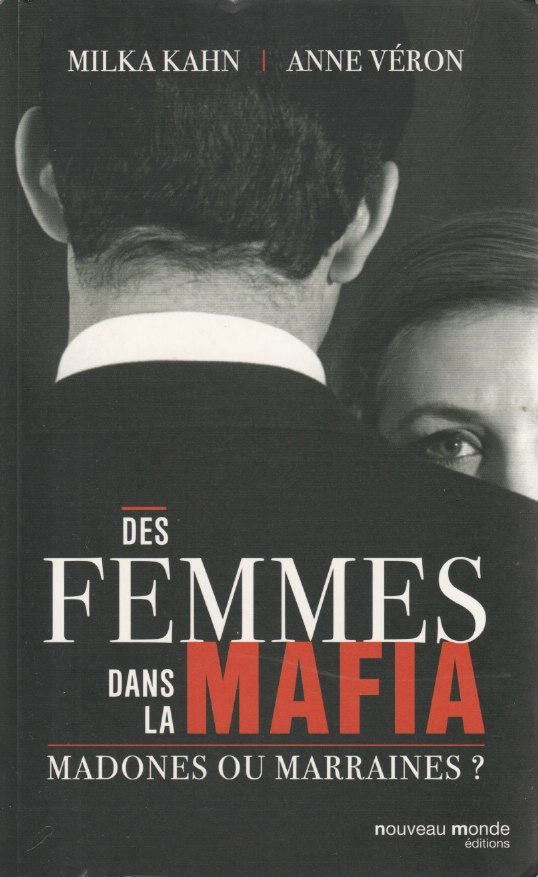
La question de l’égalité entre les femmes et les hommes est rarement évoquée à l’aune du rôle des premières dans le monde du crime organisé. Or, les réseaux criminels sont des micro-sociétés, avec leurs codes, leur culture, leurs lois, une organisation clairement définie, un partage des rôles et des tâches, et en ce qui concerne particulièrement les mafias italiennes, celles-ci donnent aux familles au sens classique (parents et enfants) une place majeure dans leur structure et leur fonctionnement. La question de l’égalité entre les femmes et les hommes s’y pose donc au même titre, que dans la société au sens général. C’est de ce point de vue que le livre Des Femmes dans la Mafia, madones ou marraines ? rédigé par Milka Kahn, juriste, et Anne Véron, réalisatrice, toutes deux spécialistes des mafias italiennes, m’a intéressé.
Une dimension schizophrénique
Ce livre à la fois passionnant et effrayant, parce que terriblement fidèle à la sombre réalité des entreprises mafieuses, propose plusieurs niveaux de lecture et de réflexion. C’est d’abord un document d’information extrêmement fouillé sur le fonctionnement des mafias. Sans concession au romantisme ou aux mythes, cette enquête dissèque la réalité brutale, violente et parfois difficilement soutenable, du fonctionnement, de l’organisation et des mentalités mafieuses. De ce point de vue, il interroge déjà sur la psychologie de ces criminels, qui ne sont pas de circonstance mais habituels, commettent des crimes effroyables y compris sur des femmes et des enfants, tout en revendiquant une morale, ce qu’ils nomment « code d’honneur », qui impose notamment le respect des valeurs familiales traditionnelles, voire religieuses, telles que le mariage, l’éducation des enfants (y compris dans la culture de la délinquance et du crime), la fidélité, l’interdiction du divorce, la punition de l’adultère. D’un point de vue psycho-médical, on est clairement dans la schizophrénie.
Criminelles pour l’honneur
Ensuite, et surtout, cette enquête retrace les parcours de plusieurs femmes qui, souvent en raison de l’absence forcée de leurs époux assassinés ou emprisonnés pour de longues durées, voire à vie, se sont trouvées investies du pouvoir et du devoir (le « code d’honneur ») de préserver et faire prospérer les affaires criminelles de leurs maris (leurs frères, leurs cousins…) En ce qui concerne précisément la camorra napolitaine, ce sont parfois les femmes qui choisissent de devenir des égéries du crime, à la fois par leur caractère fort, et pour démontrer qu’elles peuvent être les égales des hommes. Et toutes ces femmes, pourtant emprisonnées et écrasées dans un monde patriarcal brutal et machiste, dès lors qu’elles prennent la direction des affaires, dans lesquelles elles rivalisent en monstruosité avec les pires criminels, deviennent des icônes respectées par leurs homologues masculins.
Les femmes, piliers de la tradition du crime
C’est évidemment ce second volet, celui des « madones » et/ou « marraines » (en l’occurrence, le féminin de « parrain » au sens mafieux), qui interpelle sur le plan de la condition des femmes dans une société, et il pose deux questions.
La première, évidente, amène à se demander si une femme qui exerce le même pouvoir qu’un homme, avec la même brutalité dans le crime et les mêmes modes opératoires, incarne une victoire du féminisme en termes d’émancipation, de parité et d’égalité ?
La seconde, que les auteures mettent en exergue, est plus subtile mais plus significative peut-être, car elle repose non sur une réflexion, mais sur un constat, factuel et incontestable : en l’absence (fréquente dans la mafia) des hommes, ce sont les femmes, qu’elles soient dans l’ombre ou au sommet, donc toutes les femmes présentes de gré ou de force (car elles ont rarement le choix, sauf à risquer leur vie) dans ces réseaux, qui éduquent leurs enfants dans le respect des lois, des codes et des traditions du « milieu », qui leur enseignent la délinquance (qui les conduira très certainement au crime), entretiennent à leurs yeux le culte du père (des frères, des oncles, des cousins…) criminels, les emmènent le visiter en prison en vénérant son image comme celle d’un héros… Pour certains témoins rencontrés par les auteures, notamment des femmes investies dans la lutte contre la mafia, ce sont ces mères, ces sœurs, ces « marraines », qui incarnent les piliers sur lesquels survit et se perpétue la mafia.
La rupture, véritable voie pour l’émancipation
Alors, sommes-nous ici face à une victoire du féminisme dans sa quête d’émancipation et d’égalité avec les hommes ? Ou au contraire, s’agit-il de la reproduction de schémas patriarcaux spécifiques imposés par les hommes, et donc d’un simple mimétisme, synonyme de continuité de la soumission des femmes sous une apparence trompeuse ?
Une juge anti-mafia citée dans cette enquête apporte peut-être une réponse, positive et rassurante, un éclair d’espoir dans ce monde sombre et tragique. A ses yeux, les femmes de la mafia qui accèdent réellement à la liberté et à l’émancipation, ce sont les « repenties ». Celles qui, au risque de leur vie, au prix du sacrifice de leur liberté (car contraintes de vivre sous protection, sous fausse identité et loin des leurs et de leur lieu natal), décident de quitter (« trahir » aux yeux de leurs familles) la société criminelle et de collaborer avec la justice, afin de lutter contre le crime, et si possible, d’en préserver leurs enfants.
En ce sens, la véritable émancipation des femmes repose non sur l’imitation ou la reproduction de schémas mis en place et imposés par des hommes et une tradition patriarcale masculiniste, mais s’exprime et se réalise, au contraire, dans une rupture totale avec ces structures archaïques.
Des Femmes dans la Mafia, madones ou marraines ? Milka Kahn et Anne Véron, éditions du Nouveau Monde, 2015.


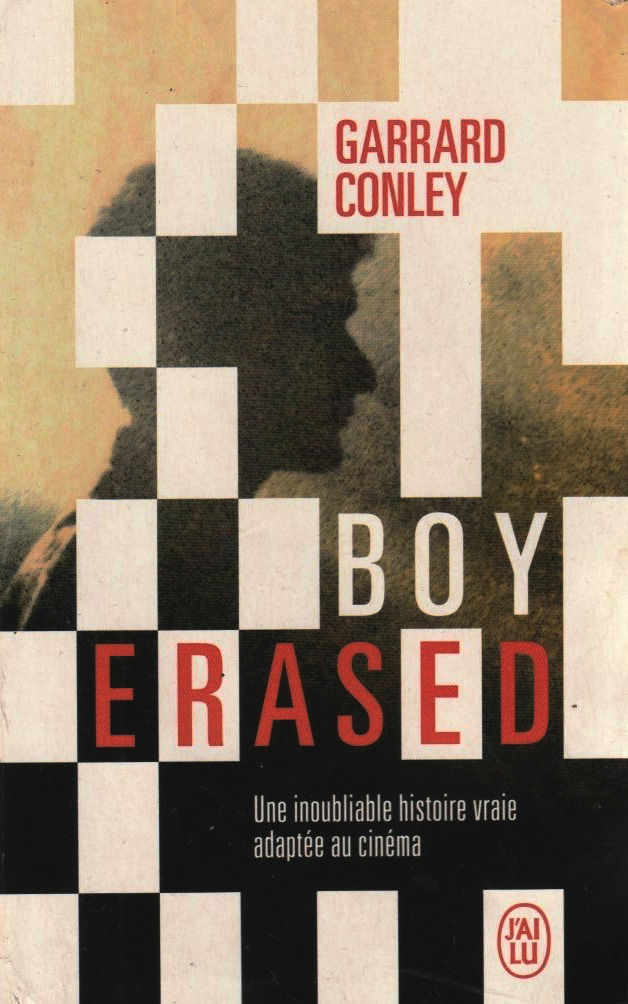


Comments